Rosa e Orticha, Ensemble Syntagma
Mundus et Musica, Qualia
La rose et l'ortie, le monde et la musique, deux titres comme autant de visages d'une musique ancienne que l'on découvre toujours plus multiforme. D'un côté, l'évocation des senteurs d'un jardin médiéval que l'on découvre italien en en franchissant le seuil, de l'autre celle de l'atmosphère du cabinet d'un savant au début de la Renaissance dans la pénombre duquel s'élaboreraient les compositions les plus fantasques. J'ai souhaité vous présenter conjointement ces disques publiés par Carpe Diem, un label indépendant dont le nom teinté d'hédonisme ne doit pas faire oublier le courage qu'il faut aujourd'hui pour enregistrer ces répertoires réputés si peu vendeurs, car si tout semble les opposer, ils sont indiscutablement unis par un raffinement commun mais aussi par leur dette évidente envers le travail mené par Pedro Memelsdorff à la tête de son ensemble Mala Punica, dont on s'aperçoit, au fil des années, à quel point il a profondément bouleversé l'approche de ces musiques.
 Andrea di Bonaiuto, dit Andrea da Firenze (Florence, fl. 1346-1379),
Andrea di Bonaiuto, dit Andrea da Firenze (Florence, fl. 1346-1379),
L'Exaltation de l’œuvre des Dominicains (détail), c.1366-68
Fresque, Florence, Basilique Santa Maria Novella, salle capitulaire
Le nom de l'ensemble Syntagma n'est pas inconnu à ceux qui s'intéressent à la musique du Moyen Âge dont ils ont exploré, souvent avec une belle réussite, des pans septentrionaux assez négligés, comme les trouvères lorrains, en particulier Gautier d'Épinal, ou de plus méridionaux, aujourd'hui mieux connus, tels la seconde moitié du Trecento italien à laquelle est consacré Rosa e Orticha, quatrième disque des musiciens réunis autour d'Alexandre Danilevski. Cette fort belle anthologie, semée de ces gemmes brillants signés par des compositeurs actifs dans le dernier quart du XIVe siècle et aujourd'hui obscurs, nous entraîne dans les cours ultramontaines où l'on déployait alors des trésors d'inventivité pour offrir des œuvres conjuguant à la fois complexité d'écriture et fluidité mélodique, une synthèse qui, s'il elle regarde parfois vers la subtilitas française contemporaine, en tempère les folles et quelquefois arides spéculations en adoptant des rythmes de danse et en faisant place à un certain lyrisme, tous deux garants d'un réel pouvoir de séduction. Une des formes les plus en vogue de cette époque et largement représentée dans Rosa e Orticha est la ballata, une chanson aux origines chorégraphiques qui devint polyphonique à partir des années 1360 et jouit d'une grande popularité jusqu'au début du siècle suivant. Je ne serais d'ailleurs pas totalement surpris qu'Andrea da Firenze ou le commanditaire des fresques de la salle capitulaire de Santa Maria Novella, lorsqu'ils décidèrent d'y faire figurer des groupes de musiciens, chanteurs et danseurs, aient eu à l'esprit ce type de pièce, dont on sait qu'il était très goûté dans les cercles lettrés florentins.
 Une des grandes vertus de l'enregistrement de l'Ensemble Syntagma est de ne perdre de vue aucune des caractéristiques de ces musiques et d'en proposer une lecture d'une grande beauté sonore, bien mise en valeur par une prise de son réverbérée mais sans excès, servie par de très bons chanteurs et instrumentistes dont on sent qu'ils ont pris le temps de travailler leur sujet. Si elle cède parfois à la mode de ces improvisations instrumentales, plus ou moins développées, avec flûte et à des couleurs un rien orientalisantes, éléments dont il est permis de douter de l'absolue rectitude historique, il faut louer cette interprétation de s'en tenir à un usage raisonnable des percussions et de faire la part belle à des textures à la fois bien maîtrisées et sensuelles, toujours d'une grande limpidité et d'un naturel qui fait oublier que ce répertoire abonde, au sens propre ce mot, en artifices. J'ai particulièrement apprécié le fait que rien, dans cette réalisation, ne soit jamais univoque et que l'on sente, sous les ondulations de la danse, pointer parfois un rien de mélancolie dans les pièces qui semblent l'exiger. Il me semble donc que ses qualités et son équilibre rendent cette anthologie parfaitement recommandable pour les amateurs de musique italienne de ce Trecento si fourmillant de trouvailles dans toutes les disciplines artistiques.
Une des grandes vertus de l'enregistrement de l'Ensemble Syntagma est de ne perdre de vue aucune des caractéristiques de ces musiques et d'en proposer une lecture d'une grande beauté sonore, bien mise en valeur par une prise de son réverbérée mais sans excès, servie par de très bons chanteurs et instrumentistes dont on sent qu'ils ont pris le temps de travailler leur sujet. Si elle cède parfois à la mode de ces improvisations instrumentales, plus ou moins développées, avec flûte et à des couleurs un rien orientalisantes, éléments dont il est permis de douter de l'absolue rectitude historique, il faut louer cette interprétation de s'en tenir à un usage raisonnable des percussions et de faire la part belle à des textures à la fois bien maîtrisées et sensuelles, toujours d'une grande limpidité et d'un naturel qui fait oublier que ce répertoire abonde, au sens propre ce mot, en artifices. J'ai particulièrement apprécié le fait que rien, dans cette réalisation, ne soit jamais univoque et que l'on sente, sous les ondulations de la danse, pointer parfois un rien de mélancolie dans les pièces qui semblent l'exiger. Il me semble donc que ses qualités et son équilibre rendent cette anthologie parfaitement recommandable pour les amateurs de musique italienne de ce Trecento si fourmillant de trouvailles dans toutes les disciplines artistiques.
 Maître anonyme, Bruges, XVe siècle,
Maître anonyme, Bruges, XVe siècle,
Simon de Hesdin au travail dans son cabinet, 1479
Enluminure sur parchemin extraite des Facta et Dicta memorabilia de Valère Maxime traduits par Simon de Hesdin et Nicholas de Gonesse, 48 x 34 cm, Ms Royal 18 E III, Londres, British Library
Le disque du tout jeune ensemble Qualia, réunissant trois musiciens à l'expertise reconnue dans leur domaine – Anna Danilevskaia à la vièle, Christophe Deslignes à l'organetto et Lambert Colson, qui le dirige, aux flûtes et cornets –, nous entraîne un bon siècle plus tard, dans les dernières années du XVe siècle durant lesquelles nos vieux manuels d'histoire voulaient situer la transition entre Moyen Âge et Renaissance, périodisation largement (et justement) contestée depuis quelques décennies. Ils font partie de ces musiciens qui, fort heureusement pour nous, tentent aujourd'hui de ressusciter une des parties du répertoire médiéval ou primo-renaissant qui a longtemps été regardée avec le plus de circonspection : la musique instrumentale ; leur Mundus et Musica s'inscrit dans une série de réussites signées par La Morra (Von edler Art, I dilettosi fiori), le Leones Ensemble (Josquin, Agricola) et Tasto Solo (Meyster ob allen Meystern) qui toutes ont contribué à remettre en questions quelques certitudes. C'est également ce que fait Qualia en s'emparant du Codex Segovia, un manuscrit réalisé à la toute fin du XVe siècle, très probablement dans l'entourage de la cour d'Espagne, par un copiste parfaitement imprégné de culture flamande, un fait qui constitue une preuve supplémentaire des liens qui unissaient alors ces deux cultures. Que trouve-t-on dans cette précieuse source ? Rien de moins que des œuvres composées par une partie du gratin des compositeurs septentrionaux de l'époque – Obrecht, Agricola, Tinctoris, Compère, Hayne van Ghizeghem, on peut trouver générique moins flatteur – qui, outre des pièces récentes de leur crû, proposent également, selon l'habitude d'un temps où faire ce que nous appellerions aujourd’hui une reprise était à la fois signe d'hommage et acte d'émulation, des élaborations nouvelles de certaines chansons du passé couronnées par le succès (Comme femme desconfortée de Binchois, D'ung aultre amer d'Ockeghem, entre autres). Ces musiques, souvent d'une grande complexité héritée de la manière d'une préciosité chantournée typique de l'Ars subtilior qui fleurissait en France un petit siècle plus tôt, ont longtemps été considérées comme de purs exercices spéculatifs non destinés, donc, à être exécutés.
 Qualia apporte à cette hypothèse un cinglant démenti en proposant une lecture d'une vitalité revigorante d'une sélection de pièces tirées du Codex Segovia et d'autres sources proches. Les trois musiciens abordent ces pièces souvent brèves (leur durée moyenne se situe autour de 2 minutes 30) avec une franchise, une finesse de touche, un souci de la couleur et une inventivité qui font plaisir à entendre et montrent qu'il existe une véritable relève en marche dans le domaine de la musique ancienne. Les diminutions les plus périlleuses, les détours mélodiques les plus inattendus sont affrontés avec l'aplomb que permet une excellente connaissance des secrets de ce répertoire assez peu fréquenté et une virtuosité révélatrice d'un travail préparatoire exigeant visant à dépasser la technique pour laisser le champ libre à l'expression et à la liberté. Il ne manque, à mon goût, à cette anthologie superbement maîtrisée qu'un rien de variété supplémentaire pour séduire complètement au delà du public familier de ces musiques que ses propositions ne manqueront pas de passionner durablement. Les premiers pas de Qualia au disque sont néanmoins extrêmement prometteurs et l'on se réjouit de retrouver, dans un avenir que l'on espère pas trop lointain, Lambert Colson et ses amis dans les nouvelles explorations que leur enthousiasme et leur intelligence ne manqueront pas de leur autoriser.
Qualia apporte à cette hypothèse un cinglant démenti en proposant une lecture d'une vitalité revigorante d'une sélection de pièces tirées du Codex Segovia et d'autres sources proches. Les trois musiciens abordent ces pièces souvent brèves (leur durée moyenne se situe autour de 2 minutes 30) avec une franchise, une finesse de touche, un souci de la couleur et une inventivité qui font plaisir à entendre et montrent qu'il existe une véritable relève en marche dans le domaine de la musique ancienne. Les diminutions les plus périlleuses, les détours mélodiques les plus inattendus sont affrontés avec l'aplomb que permet une excellente connaissance des secrets de ce répertoire assez peu fréquenté et une virtuosité révélatrice d'un travail préparatoire exigeant visant à dépasser la technique pour laisser le champ libre à l'expression et à la liberté. Il ne manque, à mon goût, à cette anthologie superbement maîtrisée qu'un rien de variété supplémentaire pour séduire complètement au delà du public familier de ces musiques que ses propositions ne manqueront pas de passionner durablement. Les premiers pas de Qualia au disque sont néanmoins extrêmement prometteurs et l'on se réjouit de retrouver, dans un avenir que l'on espère pas trop lointain, Lambert Colson et ses amis dans les nouvelles explorations que leur enthousiasme et leur intelligence ne manqueront pas de leur autoriser.
 Rosa e Orticha, musique du Trecento
Rosa e Orticha, musique du Trecento
Ensemble Syntagma
Alexandre Danilevski, luths & direction
1 CD Carpe Diem [durée totale : 60'23"] CD-16287. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.
Extraits proposés :
1. Egidius de Francia (XIVe siècle), Donna s'amor, ballata
3. Andrea Stefani (fl. c.1400), Con tutta gentilezza, ballata
Un extrait de chaque plage du disque peut être écouté ci-dessous grâce à Qobuz.com :
 Mundus et Musica, musique instrumentale en Espagne et en Flandres autour de 1500
Mundus et Musica, musique instrumentale en Espagne et en Flandres autour de 1500
Qualia
Lambert Colson, flûtes à bec, cornets & direction
1 CD Carpe Diem [durée totale : 53'18"] CD-16294. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.
Extraits proposés :
2. Magister Gulielmus (Guglielmo Ebreo da Pesaro, c.1420-après 1484), La Spagna/Falla con misuras
4. Fray Benito (XVe siècle ?), Gloria
Un extrait de chaque plage du disque peut être écouté ci-dessous grâce à Qobuz.com :














 Sérénade « Posthorn », KV 320. Musique de ballet pour Idomeneo, KV 367. 1 CD L’Oiseau-Lyre/Decca 452 604-2. Indisponible.
Sérénade « Posthorn », KV 320. Musique de ballet pour Idomeneo, KV 367. 1 CD L’Oiseau-Lyre/Decca 452 604-2. Indisponible.


 Œuvres complètes pour pianoforte. 1 CD Genuin Musikproduktion GEN 86061. Ce disque peut être acheté
Œuvres complètes pour pianoforte. 1 CD Genuin Musikproduktion GEN 86061. Ce disque peut être acheté 

 Cantates pour la Pentecôte (1737). 1 CD CPO 999 876-2. Ce disque peut être acheté
Cantates pour la Pentecôte (1737). 1 CD CPO 999 876-2. Ce disque peut être acheté  Georg Friedrich Haendel, Le Messie, 2 CD Philips 434 297-2. Ce disque peut être acheté
Georg Friedrich Haendel, Le Messie, 2 CD Philips 434 297-2. Ce disque peut être acheté 
 Ballades, 3 Nocturnes. 1 CD Narodowy Instytut Fryderryka Chopina NIFCCD 003. Ce disque peut-être acheté
Ballades, 3 Nocturnes. 1 CD Narodowy Instytut Fryderryka Chopina NIFCCD 003. Ce disque peut-être acheté 
 Évoquer Wilhelm Friedemann Bach, c’est se trouver confronté à un immense sentiment de gâchis. L’homme, en effet, avait tout pour réussir une brillante carrière. Né à Weimar le 22 novembre 1710, il est le fils aîné et aimé de l’immense Johann Sebastian Bach (1685-1750), qui parlera toujours de lui comme de son préféré. Si « Friede » fait précocement preuve d’indéniables dispositions pour la musique, son père, qui n’a pas eu la possibilité de faire de longues études, tient à ce que sa progéniture ne soit pas privée de cette opportunité : en 1729, Wilhelm Friedemann entre à l’université de Leipzig pour faire son droit ; il y étudiera également les mathématiques et la philosophie. Son éducation musicale, elle, se déroule naturellement au sein du cercle familial. Le Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach, anthologie de 63 pièces pour clavier constituée par Johann Sebastian à partir de 1720 et qui sera alimentée jusque vers 1725-26, témoigne du soin apporté à cet apprentissage ainsi que des progrès rapides de l’élève, que son père envoie en outre, entre juillet 1726 et avril 1727, se perfectionner dans la technique du violon auprès de Johann Gottlieb Graun (1702/03-1771), élève de Pisendel et de Tartini. C’est donc un musicien accompli qui brigue, en 1731, le poste d’organiste d’Halberstadt, qu’il n’obtient pas, bien que les autorités reconnaissent la supériorité de son talent, puis accompagne son père à Dresde, véritable capitale musicale européenne à cette époque. Deux ans plus tard, le poste de la Sophienkirche de la ville étant devenu vacant, Wilhelm Friedemann fait acte de candidature ; il est choisi, après audition, à l’unanimité et prend ses fonctions le 1er août 1733.
Évoquer Wilhelm Friedemann Bach, c’est se trouver confronté à un immense sentiment de gâchis. L’homme, en effet, avait tout pour réussir une brillante carrière. Né à Weimar le 22 novembre 1710, il est le fils aîné et aimé de l’immense Johann Sebastian Bach (1685-1750), qui parlera toujours de lui comme de son préféré. Si « Friede » fait précocement preuve d’indéniables dispositions pour la musique, son père, qui n’a pas eu la possibilité de faire de longues études, tient à ce que sa progéniture ne soit pas privée de cette opportunité : en 1729, Wilhelm Friedemann entre à l’université de Leipzig pour faire son droit ; il y étudiera également les mathématiques et la philosophie. Son éducation musicale, elle, se déroule naturellement au sein du cercle familial. Le Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach, anthologie de 63 pièces pour clavier constituée par Johann Sebastian à partir de 1720 et qui sera alimentée jusque vers 1725-26, témoigne du soin apporté à cet apprentissage ainsi que des progrès rapides de l’élève, que son père envoie en outre, entre juillet 1726 et avril 1727, se perfectionner dans la technique du violon auprès de Johann Gottlieb Graun (1702/03-1771), élève de Pisendel et de Tartini. C’est donc un musicien accompli qui brigue, en 1731, le poste d’organiste d’Halberstadt, qu’il n’obtient pas, bien que les autorités reconnaissent la supériorité de son talent, puis accompagne son père à Dresde, véritable capitale musicale européenne à cette époque. Deux ans plus tard, le poste de la Sophienkirche de la ville étant devenu vacant, Wilhelm Friedemann fait acte de candidature ; il est choisi, après audition, à l’unanimité et prend ses fonctions le 1er août 1733.
 Ce nouveau poste semble plus prometteur que le précédent : un salaire quasi doublé, l’obligation, outre d’accompagner les offices à l’orgue, de fournir des œuvres pour les trois églises de la ville. Mais Halle n’offre pas à la musique des conditions matérielles aussi brillantes que Dresde, ni même que Leipzig, loin de là. Le goût musical y est plutôt conservateur, chanteurs et instrumentistes (seulement 9 permanents en 1746) sont répartis entre les différentes églises, dans lesquelles on ne donne de cantates qu’un dimanche sur trois, sans qu’elles soient nécessairement de la plume du directeur de la musique lorsqu’elles prennent place lors des offices dominicaux ordinaires. Wilhelm Friedemann n’aura donc jamais l’occasion de composer de cycles de cantates comme l’a fait son père et sa production de musique sacrée, qui occupera largement ses années à Halle, demeurera modeste : une trentaine d’œuvres, dont une vingtaine de cantates et deux messes.
Ce nouveau poste semble plus prometteur que le précédent : un salaire quasi doublé, l’obligation, outre d’accompagner les offices à l’orgue, de fournir des œuvres pour les trois églises de la ville. Mais Halle n’offre pas à la musique des conditions matérielles aussi brillantes que Dresde, ni même que Leipzig, loin de là. Le goût musical y est plutôt conservateur, chanteurs et instrumentistes (seulement 9 permanents en 1746) sont répartis entre les différentes églises, dans lesquelles on ne donne de cantates qu’un dimanche sur trois, sans qu’elles soient nécessairement de la plume du directeur de la musique lorsqu’elles prennent place lors des offices dominicaux ordinaires. Wilhelm Friedemann n’aura donc jamais l’occasion de composer de cycles de cantates comme l’a fait son père et sa production de musique sacrée, qui occupera largement ses années à Halle, demeurera modeste : une trentaine d’œuvres, dont une vingtaine de cantates et deux messes.
 S’il est un homme intensément représentatif de la fracture entre deux esthétiques, c’est bien Wilhelm Friedemann Bach. Ses racines appartiennent profondément, par son éducation comme par son milieu, au monde baroque, mais son regard et ce que l’on peut percevoir de sa sensibilité se portent déjà au-delà. Nombre d’éléments de ce nouvel univers sont déjà en germe dans son œuvre, et il ne lui a sans doute manqué que la discipline de vie – notons, à ce propos, les problèmes insolubles que pose l’établissement d’une chronologie de ses compositions puisqu’il n’a jamais dressé de catalogue et a montré peu d’égards pour ses propres manuscrits – et l’envie de réussir de son frère, Carl Philipp Emanuel, pour en explorer tous les chemins. Bach père a sans doute trop dit à son aîné qu’il était un musicien exceptionnel, il l’a sans doute, comme on dirait de nos jours, trop jalousement couvé, et, ce faisant, fragilisé en lui faisant nourrir un sentiment de supériorité parfaitement incompatible avec le statut de domestique encore attaché, à l’époque, au métier de musicien, mais aussi en l’empêchant d’acquérir une véritable autonomie. Ceci pourrait largement expliquer, outre, comme on l’a vu, des contextes systématiquement peu favorables qu’il s’est révélé impuissant à changer, son incapacité à conserver un poste stable (on retrouve le même schéma chez Mozart) et la constance avec laquelle il s’est marginalisé. La comparaison avec la carrière et l’œuvre de Carl Philipp Emanuel, le fils cadet contraint d’imposer une voix que le rang de la naissance menaçait d’étouffer, ou de Johann Christian (1735-1782), qui n’a connu qu’un Cantor vieillissant et a largement été éduqué musicalement par Carl Philipp Emanuel, sont éloquentes. Ce sont sans doute les deux fils qui, en faisant valoir leur propre style, « sensible » chez l’un, « galant » chez l’autre, se sont le plus radicalement écartés de la voie du père, avec le succès que l’on sait.
S’il est un homme intensément représentatif de la fracture entre deux esthétiques, c’est bien Wilhelm Friedemann Bach. Ses racines appartiennent profondément, par son éducation comme par son milieu, au monde baroque, mais son regard et ce que l’on peut percevoir de sa sensibilité se portent déjà au-delà. Nombre d’éléments de ce nouvel univers sont déjà en germe dans son œuvre, et il ne lui a sans doute manqué que la discipline de vie – notons, à ce propos, les problèmes insolubles que pose l’établissement d’une chronologie de ses compositions puisqu’il n’a jamais dressé de catalogue et a montré peu d’égards pour ses propres manuscrits – et l’envie de réussir de son frère, Carl Philipp Emanuel, pour en explorer tous les chemins. Bach père a sans doute trop dit à son aîné qu’il était un musicien exceptionnel, il l’a sans doute, comme on dirait de nos jours, trop jalousement couvé, et, ce faisant, fragilisé en lui faisant nourrir un sentiment de supériorité parfaitement incompatible avec le statut de domestique encore attaché, à l’époque, au métier de musicien, mais aussi en l’empêchant d’acquérir une véritable autonomie. Ceci pourrait largement expliquer, outre, comme on l’a vu, des contextes systématiquement peu favorables qu’il s’est révélé impuissant à changer, son incapacité à conserver un poste stable (on retrouve le même schéma chez Mozart) et la constance avec laquelle il s’est marginalisé. La comparaison avec la carrière et l’œuvre de Carl Philipp Emanuel, le fils cadet contraint d’imposer une voix que le rang de la naissance menaçait d’étouffer, ou de Johann Christian (1735-1782), qui n’a connu qu’un Cantor vieillissant et a largement été éduqué musicalement par Carl Philipp Emanuel, sont éloquentes. Ce sont sans doute les deux fils qui, en faisant valoir leur propre style, « sensible » chez l’un, « galant » chez l’autre, se sont le plus radicalement écartés de la voie du père, avec le succès que l’on sait. Pourtant, chez Wilhelm Friedemann, tous les éléments de la réussite sont là. Maîtrise absolue des techniques d’écriture, inventivité réelle, capacité à composer dans des styles très divers, du plus léger au plus sérieux, toutes ces qualités s’imposent à l’écoute de ses œuvres pour clavier seul – sans doute la part la plus personnelle de sa production, celle où il expérimente et se dévoile le plus –, comme de ses concertos ou des quelques cantates qui ont été portées au disque. Certes, la grande ombre du père plane toujours plus ou moins, particulièrement dans le domaine de la musique sacrée, sur ses compositions, mais elles contiennent toujours des échappées qui les rapprochent de l’Empfindsamer Stil (« style sensible ») dont Carl Philipp Emanuel sera sinon l’inventeur, du moins le champion, colorant, par leurs ruptures subites, leurs suspensions imprévisibles, leurs chromatismes douloureux, maintes pages d’indéniables élans préromantiques. Sans son besoin viscéral de recueillir l’assentiment du Cantor (notons, pour l’anecdote, que Wilhelm Friedemann ne se mariera qu’un an après la mort de ce dernier), l’aîné des fils Bach aurait sans doute été mieux à même de faire valoir son originalité foncière en l’intégrant, à l’instar de son cadet, dans un véritable projet esthétique. Reste l’image d’un compositeur que ses tentatives de synthèse entre « ancien » et « nouveau » langage musical rendent passionnant et son parcours personnel chaotique terriblement attachant, et dont bien des œuvres, notamment sacrées, attendent toujours leur résurrection.
Pourtant, chez Wilhelm Friedemann, tous les éléments de la réussite sont là. Maîtrise absolue des techniques d’écriture, inventivité réelle, capacité à composer dans des styles très divers, du plus léger au plus sérieux, toutes ces qualités s’imposent à l’écoute de ses œuvres pour clavier seul – sans doute la part la plus personnelle de sa production, celle où il expérimente et se dévoile le plus –, comme de ses concertos ou des quelques cantates qui ont été portées au disque. Certes, la grande ombre du père plane toujours plus ou moins, particulièrement dans le domaine de la musique sacrée, sur ses compositions, mais elles contiennent toujours des échappées qui les rapprochent de l’Empfindsamer Stil (« style sensible ») dont Carl Philipp Emanuel sera sinon l’inventeur, du moins le champion, colorant, par leurs ruptures subites, leurs suspensions imprévisibles, leurs chromatismes douloureux, maintes pages d’indéniables élans préromantiques. Sans son besoin viscéral de recueillir l’assentiment du Cantor (notons, pour l’anecdote, que Wilhelm Friedemann ne se mariera qu’un an après la mort de ce dernier), l’aîné des fils Bach aurait sans doute été mieux à même de faire valoir son originalité foncière en l’intégrant, à l’instar de son cadet, dans un véritable projet esthétique. Reste l’image d’un compositeur que ses tentatives de synthèse entre « ancien » et « nouveau » langage musical rendent passionnant et son parcours personnel chaotique terriblement attachant, et dont bien des œuvres, notamment sacrées, attendent toujours leur résurrection. 1 CD Mirare MIR 088. Ce disque peut être acheté
1 CD Mirare MIR 088. Ce disque peut être acheté  1 CD Carus 83.304. Ce disque peut être acheté
1 CD Carus 83.304. Ce disque peut être acheté  1 CD Ricercar 206312. Indisponible.
1 CD Ricercar 206312. Indisponible. 1 CD Capriccio 10425 (volume 1). Ce disque peut être acheté
1 CD Capriccio 10425 (volume 1). Ce disque peut être acheté  1 CD Capriccio 10426 (volume 2). Ce disque peut être acheté
1 CD Capriccio 10426 (volume 2). Ce disque peut être acheté 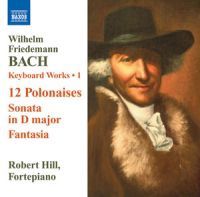 1 CD Naxos 8.557966. Ce disque peut être acheté
1 CD Naxos 8.557966. Ce disque peut être acheté 
 Opera arias (Gluck, Mozart, Haydn). 1 CD Archiv Produktion
Opera arias (Gluck, Mozart, Haydn). 1 CD Archiv Produktion 
 En 1741, Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788, portrait gravé ci-contre), fils de son illustre père, est au service de Frédéric II à Berlin. Même s’il est clair que le Cantor nourrira toujours une préférence pour l’aîné de ses rejetons, le talentueux mais incertain Wilhelm Friedemann (1710-1784), il va cependant sans dire que l’éducation de Carl Philipp Emanuel a été soignée et lui a conféré toutes les bases nécessaires pour devenir un musicien émérite. Dès ses toutes premières œuvres, comme le Concerto en la mineur pour clavier, écrit en 1733 alors qu’il se trouvait encore au foyer paternel, puis remanié en 1744, dont le dernier mouvement vous est proposé en tête de billet, il est évident que si l’héritage des compositeurs baroques, qu’il s’agisse d’Antonio Vivaldi (1678-1741) pour les ritournelles ou de Johann Sebastian Bach (1685-1750) pour l’architecture, a été parfaitement assimilé, la manière de souligner les contrastes et de tendre le tissu musical en le parsemant d’accidents assez imprévisibles regarde déjà au-delà des conventions de l’époque. Faut-il y voir la réaction d’un cadet contraint de sortir des sentiers battus pour faire entendre sa voix ? Ce n’est pas à exclure, mais Carl Philipp Emanuel sera bien plus que ceci : il va tout simplement changer la face de la musique de son temps, ce que reconnaîtront contemporains et postérité au moins jusqu’à Mendelssohn (1809-1847).
En 1741, Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788, portrait gravé ci-contre), fils de son illustre père, est au service de Frédéric II à Berlin. Même s’il est clair que le Cantor nourrira toujours une préférence pour l’aîné de ses rejetons, le talentueux mais incertain Wilhelm Friedemann (1710-1784), il va cependant sans dire que l’éducation de Carl Philipp Emanuel a été soignée et lui a conféré toutes les bases nécessaires pour devenir un musicien émérite. Dès ses toutes premières œuvres, comme le Concerto en la mineur pour clavier, écrit en 1733 alors qu’il se trouvait encore au foyer paternel, puis remanié en 1744, dont le dernier mouvement vous est proposé en tête de billet, il est évident que si l’héritage des compositeurs baroques, qu’il s’agisse d’Antonio Vivaldi (1678-1741) pour les ritournelles ou de Johann Sebastian Bach (1685-1750) pour l’architecture, a été parfaitement assimilé, la manière de souligner les contrastes et de tendre le tissu musical en le parsemant d’accidents assez imprévisibles regarde déjà au-delà des conventions de l’époque. Faut-il y voir la réaction d’un cadet contraint de sortir des sentiers battus pour faire entendre sa voix ? Ce n’est pas à exclure, mais Carl Philipp Emanuel sera bien plus que ceci : il va tout simplement changer la face de la musique de son temps, ce que reconnaîtront contemporains et postérité au moins jusqu’à Mendelssohn (1809-1847). Tout ce que l’on pouvait percevoir en filigrane dans les deux œuvres précédentes explose dans l’Allegro assai liminaire de cette Symphonie en mi mineur datable d’environ 1756, que, si l’on en croit le globe-trotter européen et mélomane Charles Burney (1726-1814), le très italianisé Hasse, pourtant plus ou moins complètement étranger à ce style ébouriffé, admirait au plus haut point. On voit ici l’affirmation d’une esthétique basée sur une intense trépidation rythmique ainsi que sur la fragmentation du discours musical, notamment au travers de l’utilisation consommée des silences et des ruptures dynamiques. Ces éléments agissent comme un facteur de relance permanente, amplifié par l’alternance incessante de moments de tension et de détente, sans toutefois nuire à la cohérence de l’ensemble, l’impression chaotique qui pourrait résulter de l’utilisation de brefs motifs musicaux semblant vagabonder à leur guise (un procédé dont Haydn, entre autres, se souviendra) étant toujours sous-tendue par une pensée qui sait parfaitement où elle conduit l’auditeur. Cette manière confère aux mouvements rapides une progression implacable assortie de foucades imprévues, voire véhémentes, qui tentent de traduire au mieux les fluctuations d’une âme agitée par le flux et le reflux des passions. Les mouvements lents sont eux aussi gagnés par cette variation extrêmement rapide des climats affectifs qui se manifeste, là encore, par l’irruption subite des silences et l’exacerbation des contrastes. Ils y gagnent une profondeur inédite qui ouvre largement sur l’expression, alors encore peu habituelle, d’une sensibilité empreinte d’une forte subjectivité, ainsi qu’on peut l’entendre, par exemple, dans l’extrait suivant :
Tout ce que l’on pouvait percevoir en filigrane dans les deux œuvres précédentes explose dans l’Allegro assai liminaire de cette Symphonie en mi mineur datable d’environ 1756, que, si l’on en croit le globe-trotter européen et mélomane Charles Burney (1726-1814), le très italianisé Hasse, pourtant plus ou moins complètement étranger à ce style ébouriffé, admirait au plus haut point. On voit ici l’affirmation d’une esthétique basée sur une intense trépidation rythmique ainsi que sur la fragmentation du discours musical, notamment au travers de l’utilisation consommée des silences et des ruptures dynamiques. Ces éléments agissent comme un facteur de relance permanente, amplifié par l’alternance incessante de moments de tension et de détente, sans toutefois nuire à la cohérence de l’ensemble, l’impression chaotique qui pourrait résulter de l’utilisation de brefs motifs musicaux semblant vagabonder à leur guise (un procédé dont Haydn, entre autres, se souviendra) étant toujours sous-tendue par une pensée qui sait parfaitement où elle conduit l’auditeur. Cette manière confère aux mouvements rapides une progression implacable assortie de foucades imprévues, voire véhémentes, qui tentent de traduire au mieux les fluctuations d’une âme agitée par le flux et le reflux des passions. Les mouvements lents sont eux aussi gagnés par cette variation extrêmement rapide des climats affectifs qui se manifeste, là encore, par l’irruption subite des silences et l’exacerbation des contrastes. Ils y gagnent une profondeur inédite qui ouvre largement sur l’expression, alors encore peu habituelle, d’une sensibilité empreinte d’une forte subjectivité, ainsi qu’on peut l’entendre, par exemple, dans l’extrait suivant : 1 CD BIS
1 CD BIS  1 CD Harmonia Mundi
1 CD Harmonia Mundi  1 CD BIS
1 CD BIS 

 À qui tient absolument à trouver du Mozart chez Mendelssohn, l’Andante en ré majeur qui suit ce premier mouvement quelque peu chahuté apportera une intense satisfaction. Paisible et lumineuse, cette page au lyrisme rêveur, à fleur de peau, reste fidèle aux exigences de clarté et d’équilibre de la tradition classique. Cependant, la respiration très ample, l’exaltation fiévreuse que l’on sent par instants sur le point de rompre les digues imposées par les contraintes formelles, sont déjà pleinement romantiques et nous en apprennent beaucoup sur le degré de maturité auquel était parvenu le tout jeune compositeur ainsi que sur la force des émotions qui pouvaient déjà le traverser.
À qui tient absolument à trouver du Mozart chez Mendelssohn, l’Andante en ré majeur qui suit ce premier mouvement quelque peu chahuté apportera une intense satisfaction. Paisible et lumineuse, cette page au lyrisme rêveur, à fleur de peau, reste fidèle aux exigences de clarté et d’équilibre de la tradition classique. Cependant, la respiration très ample, l’exaltation fiévreuse que l’on sent par instants sur le point de rompre les digues imposées par les contraintes formelles, sont déjà pleinement romantiques et nous en apprennent beaucoup sur le degré de maturité auquel était parvenu le tout jeune compositeur ainsi que sur la force des émotions qui pouvaient déjà le traverser. Concerto pour violon en ré mineur. Symphonie n°1 (et Schneider, Symphonie n°17 en ut mineur). 1 CD CPO
Concerto pour violon en ré mineur. Symphonie n°1 (et Schneider, Symphonie n°17 en ut mineur). 1 CD CPO